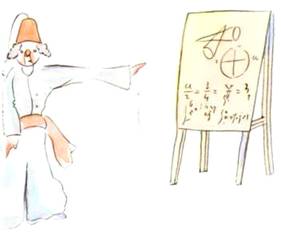8.3 Explication de texte
Exercice A. Révision – Identification du temps
Étape 1
Révisez les tableaux ci-dessous et terminez-les avec la conjugaison appropriée.
Étape 2
Révisez le tableau ci-dessous.
| à l’oral | littéraire |
|---|---|
| Un coup de vent leur a coupé la parole. | Un coup de vent leur coupa la parole. |
| Ils avaient oubliés leurs bagages. | Ils eurent oublié leurs bagages. |
Associez le temps parlé à son équivalent littéraire.
Étape 3
De nouveau, associez le temps parlé à son équivalent littéraire.
Exercice B. Compréhension du texte I
Guy de Maupassant était un écrivain du XIXe siècle, connu pour ses contes. Il faisait partie des écoles de Réalisme et de Naturalisme. Un écrivain réaliste représente la réalité le monde et les gens qu’on y trouve.
Le Naturalisme suit ce mouvement en ajoutant la psychologie des personnages et leur milieu qui démontre pourquoi les protagonistes se comportent de telle ou telle manière.
« La Parure », une histoire courte de Guy de Maupassant, est l’histoire d’une femme qui est malheureuse, et les événements qui changeront sa vie pour toujours. Lisez l’histoire plusieurs fois, pour bien comprendre l’intrigue. Après avoir lu, faites l’activité de compréhension en choisissant la bonne réponse.
C’était une de ces jolies et charmantes filles, nées, comme par une erreur du destin, dans une famille d’employés. Elle n’avait pas de dot, pas d’espérances, aucun moyen d’être connue, comprise, aimée, épousée par un homme riche et distingué ; et elle se laissa marier avec un petit commis du ministère de l’Instruction publique. […]
Elle souffrait sans cesse, se sentant née pour toutes les délicatesses et tous les luxes. Elle souffrait de la pauvreté de son logement, de la misère des murs, de l’usure des sièges, de la laideur des étoffes. Toutes ces choses, dont une autre femme de sa caste ne se serait même pas aperçue, la torturaient et l’indignaient. […]
Elle n’avait pas de toilettes, pas de bijoux, rien. Et elle n’aimait que cela ; elle se sentait faite pour cela. Elle eût tant désiré plaire, être enviée, être séduisante et recherchée.
Elle avait une amie riche, une camarade de couvent qu’elle ne voulait plus aller voir, tant elle souffrait en revenant. Et elle pleurait pendant des jours entiers, de chagrin, de regret, de désespoir et de détresse.
Or, un soir, son mari rentra, l’air glorieux et tenant à la main une large enveloppe.
– Tiens, dit-il, voici quelque chose pour toi.
Elle déchira vivement le papier et en tira une carte qui portait ces mots :
« Le ministre de l’Instruction publique et Mme Georges Ramponneau prient M. et Mme Loisel de leur faire l’honneur de venir passer la soirée à l’hôtel du ministère, le lundi 18 janvier. »
Au lieu d’être ravie, comme l’espérait son mari, elle jeta avec dépit l’invitation sur la table, murmurant :
– Que veux-tu que je fasse de cela ?
– Mais, ma chérie, je pensais que tu serais contente. Tu ne sors jamais, et c’est une occasion, cela, une belle ! J’ai eu une peine infinie à l’obtenir. Tout le monde en veut ; c’est très recherché et on n’en donne pas beaucoup aux employés. Tu verras là tout le monde officiel.
Elle le regardait d’un œil irrité, et elle déclara avec impatience :
– Que veux-tu que je me mette sur le dos pour aller là ? […] Seulement je n’ai pas de toilette et par conséquent, je ne peux aller à cette fête. Donne ta carte à quelque collègue dont la femme sera mieux nippée que moi.
Il était désolé. Il reprit :
– Voyons, Mathilde. Combien cela coûterait-il, une toilette convenable, qui pourrait te servir encore en d’autres occasions, quelque chose de très simple ? […]
Enfin, elle répondit en hésitant :
– Je ne sais pas au juste, mais il me semble qu’avec quatre cents francs je pourrais arriver.
Il avait un peu pâli, car il réservait juste cette somme pour acheter un fusil et s’offrir des parties de chasse, l’été suivant, dans la plaine de Nanterre, avec quelques amis qui allaient tirer des alouettes par-là, le dimanche.
Il dit cependant :
– Soit. Je te donne quatre cents francs. Mais tâche d’avoir une belle robe.
Le jour de la fête approchait, et Mme Loisel semblait triste, inquiète, anxieuse. Sa toilette était prête cependant. Son mari lui dit un soir :
– Qu’as-tu ? Voyons, tu es toute drôle depuis trois jours.
Et elle répondit :
– Cela m’ennuie de n’avoir pas un bijou, pas une pierre, rien à mettre sur moi. J’aurai l’air misère comme tout. J’aimerais presque mieux ne pas aller à cette soirée.
Il reprit :
– Tu mettras des fleurs naturelles. C’est très chic en cette saison-ci. Pour dix francs tu auras deux ou trois roses magnifiques.
Elle n’était point convaincue.
– Non… il n’y a rien de plus humiliant que d’avoir l’air pauvre au milieu de femmes riches.
Mais son mari s’écria :
– Que tu es bête ! Va trouver ton amie Mme Forestier et demande-lui de te prêter des bijoux. Tu es bien assez liée avec elle pour faire cela.
Elle poussa un cri de joie.
– C’est vrai. Je n’y avais point pensé.
Le lendemain, elle se rendit chez son amie et lui conta sa détresse. Mme Forestier alla vers son armoire à glace, prit un large coffret, l’apporta, l’ouvrit, et dit à Mme Loisel :
– Choisis, ma chère.
Elle vit d’abord des bracelets, puis un collier de perles, puis une croix vénitienne, or et pierreries, d’un admirable travail. Elle essayait les parures devant la glace, hésitait, ne pouvait se décider à les quitter, à les rendre. Elle demandait toujours :
– Tu n’as plus rien d’autre ?
– Mais si. Cherche. Je ne sais pas ce qui peut te plaire.
Tout à coup elle découvrit, dans une boîte de satin noir, une superbe rivière de diamants ; et son cœur se mit à battre d’un désir immodéré. Ses mains tremblaient en la prenant. Elle l’attacha autour de sa gorge, sur sa robe montante et demeura en extase devant elle-même.
Puis, elle demanda, hésitante, pleine d’angoisse :
– Peux-tu me prêter cela, rien que cela ?
– Mais oui, certainement.
Elle sauta au cou de son amie, l’embrassa avec emportement, puis s’enfuit avec son trésor.
Le jour de la fête arriva. Mme Loisel eut un succès. Elle était plus jolie que toutes, élégante, gracieuse, souriante et folle de joie. Tous les hommes la regardaient, demandaient son nom, cherchaient à être présentés. Tous les attachés du cabinet voulaient valser avec elle. Le Ministre la remarqua.
Elle dansait avec ivresse, avec emportement, grisée par le plaisir, ne pensant plus à rien, dans le triomphe de sa beauté, dans la gloire de son succès, dans une sorte de nuage de bonheur fait de tous ces hommages, de toutes ces admirations, de tous ces désirs éveillés, de cette victoire si complète et si douce au cœur des femmes.
Elle partit vers quatre heures du matin. Son mari, depuis minuit, dormait dans un petit salon désert avec trois autres messieurs dont les femmes s’amusaient beaucoup. […]
Mais soudain elle poussa un cri. Elle n’avait plus sa rivière autour du cou !
Choisissez la bonne réponse
Exercice C. Bavardons !
Répondez aux questions avec un ou une partenaire.
- Faites un portrait de Madame Loisel. Comment est son caractère ? Est-ce que M. de Maupassant nous indique les raisons pour ses attitudes ? Les trouvez-vous raisonnables ? Compatissez-vous avec elle ?
- Faites une description du mari. À votre avis, est-il un homme qui comprend sa femme ? Comment est-ce qu’il essaie de l’aider ?
- Qu’apprenons-nous de l’amie ?
- Est-ce que vous avez un sens du décor de la maison, des vêtements de Mme Loisel ? Comment est-ce que Maupassant vous aide à visualiser ces scènes ? Avez-vous une idée claire des événements de la soirée ? Pourquoi Mme Loisel est-elle si contente ? Quel événement présage un changement ?
Exercice D. À la suite – a fin de l’histoire
Continuez l’histoire de « La Parure » pour découvrir ce qui se passe.
Son mari, à moitié dévêtu déjà, demanda :
– Qu’est-ce que tu as ?
Elle se tourna vers lui, affolée :
– J’ai… j’ai… je n’ai plus la rivière de Mme Forestier.
– Quoi !… comment !… Ce n’est pas possible !
Et ils cherchèrent dans les plis de la robe, dans les plis du manteau, dans les poches, partout. Ils ne la trouvèrent point.
Son mari [Il] demandait :
– Tu es sûre que tu l’avais encore en quittant le bal ?
– Oui, je l’ai touchée dans le vestibule du Ministère. […]
Ils se contemplaient atterrés. Enfin Loisel se rhabilla.
– Je vais, dit-il, refaire tout le trajet que nous avons fait à pied, pour voir si je ne la retrouverai pas.
Et il sortit. Elle demeura en toilette de soirée, sans force pour se coucher, abattue sur une chaise, sans feu, sans pensée.
Son mari rentra vers sept heures. Il n’avait rien trouvé.
Il se rendit à la Préfecture de police, aux journaux, pour faire promettre une récompense, aux compagnies de petites voitures, partout enfin où un soupçon d’espoir le poussait.
Elle attendit tout le jour, dans le même état d’effarement devant cet affreux désastre.
Loisel revint le soir, avec la figure creusée, pâlie ; il n’avait rien découvert.
– Il faut, dit-il, écrire à ton amie que tu as brisé la fermeture de sa rivière et que tu la fais réparer. Cela nous donnera le temps de nous retourner.
Elle écrivit sous sa dictée.
Au bout d’une semaine, ils avaient perdu toute espérance. Et Loisel, vieilli de cinq ans, déclara :
– Il faut aviser à remplacer ce bijou. […]
Ils trouvèrent, dans une boutique du Palais Royal, un chapelet de diamants qui leur parut entièrement semblable à celui qu’ils cherchaient. Il valait quarante mille francs. On le leur laisserait à trente-six mille.
Ils prièrent donc le joaillier de ne pas le vendre avant trois jours. Et ils firent condition qu’on le reprendrait pour trente-quatre mille francs, si le premier était retrouvé avant la fin de février.
Loisel possédait dix-huit mille francs que lui avait laissés son père. Il emprunterait le reste.
Il emprunta, demandant mille francs à l’un, cinq cents à l’autre, cinq louis par-ci, trois louis par-là. Il fit des billets, prit des engagements ruineux, eut affaire aux usuriers, à toutes les races de prêteurs. Il compromit toute la fin de son existence, risqua sa signature sans savoir même s’il pourrait y faire honneur, et, épouvanté par les angoisses de l’avenir, par la noire misère qui allait s’abattre sur lui, par la perspective de toutes les privations physiques et de toutes les tortures morales, il alla chercher la rivière nouvelle, en déposant sur le comptoir du marchand trente-six mille francs.
Quand Mme Loisel reporta la parure à Mme Forestier, celle-ci lui dit, d’un air froissé :
– Tu aurais dû me la rendre plus tôt, car je pouvais en avoir besoin.
Elle n’ouvrit pas l’écrin, ce que redoutait son amie. Si elle s’était aperçue de la substitution, qu’aurait-elle pensé ? qu’aurait-elle dit ? Ne l’aurait-elle pas prise pour une voleuse ? Mme Loisel connut la vie horrible des nécessiteux. Elle prit son parti, d’ailleurs, tout d’un coup, héroïquement. Il fallait payer cette dette effroyable. Elle payerait. On renvoya la bonne ; on changea de logement ; on loua sous les toits une mansarde.
Elle connut les gros travaux du ménage, les odieuses besognes de la cuisine. Elle lava la vaisselle, usant ses ongles roses sur les poteries grasses et le fond des casseroles. Elle savonna le linge sale, les chemises et les torchons, qu’elle faisait sécher sur une corde ; elle descendit à la rue, chaque matin, les ordures, et monta l’eau, s’arrêtant à chaque étage pour souffler. Et, vêtue comme une femme du peuple, elle alla chez le fruitier, chez l’épicier, chez le boucher, le panier au bras, marchandant, injuriée, défendant sou à sou son misérable argent.
Il fallait chaque mois payer des billets, en renouveler d’autres, obtenir du temps. Le mari travaillait, le soir, à mettre au net les comptes d’un commerçant, et la nuit, souvent, il faisait de la copie à cinq sous la page.
Et cette vie dura dix ans.
Au bout de dix ans, ils avaient tout restitué, tout, avec le taux de l’usure, et l’accumulation des intérêts superposés.
Mme Loisel semblait vieille, maintenant. Elle était devenue la femme forte, et dure, et rude, des ménages pauvres. Mal peignée, avec les jupes de travers et les mains rouges, elle parlait haut, lavait à grande eau les planchers. Mais parfois, lorsque son mari était au bureau, elle s’asseyait auprès de la fenêtre, et elle songeait à cette soirée d’autrefois, à ce bal où elle avait été si belle et si fêtée.
Que serait-il arrivé si elle n’avait point perdu cette parure ? Qui sait ? qui sait ? Comme la vie est singulière, changeante ! Comme il faut peu de chose pour vous perdre ou vous sauver !
Or, un dimanche, comme elle était allée faire un tour aux Champs-Elysées pour se délasser des besognes de la semaine, elle aperçut tout à coup une femme qui promenait un enfant. C’était Mme Forestier, toujours jeune, toujours belle, toujours séduisante.
Mme Loisel se sentit émue. Allait-elle lui parler ? Oui, certes. Et maintenant qu’elle avait payé, elle lui dirait tout. Pourquoi pas ?
Elle s’approcha.
– Bonjour, Jeanne.
L’autre ne la reconnaissait point, s’étonnant d’être appelée ainsi familièrement par cette bourgeoise.
Elle balbutia :
– Mais… madame !… Je ne sais… Vous devez vous tromper.
– Non. Je suis Mathilde Loisel.
Son amie poussa un cri.
– Oh !… ma pauvre Mathilde, comme tu es changée !…
– Oui, j’ai eu des jours bien durs, depuis que je ne t’ai vue ; et bien des misères… et cela à cause de toi !…
– De moi . . . Comment ça ?
– Tu te rappelles bien cette rivière de diamants que tu m’as prêtée pour aller à la fête du Ministère.
– Oui. Eh bien ?
– Eh bien, je l’ai perdue.
– Comment ! puisque tu me l’as rapportée.
– Je t’en ai rapporté une autre toute pareille. Et voilà dix ans que nous la payons. Tu comprends que ça n’était pas aisé pour nous, qui n’avions rien… Enfin c’est fini, et je suis rudement contente.
Mme Forestier s’était arrêtée.
– Tu dis que tu as acheté une rivière de diamants pour remplacer la mienne ?
– Oui. Tu ne t’en étais pas aperçue, hein ! Elles étaient bien pareilles.
Et elle souriait d’une joie orgueilleuse et naïve.
Mme Forestier, fort émue, lui prit les deux mains.
– Oh ! ma pauvre Mathilde ! Mais la mienne était fausse. Elle valait au plus cinq cents francs !…
Exercice E. Bavardons !
Répondez aux questions avec un ou une partenaire.
- Qu’a fait M. Loisel pour retrouver le collier ?
- Comment est-ce que le couple a réussi à retourner le collier ? Quelles en sont les conséquences de cela pour le couple ? Détaillez comment ils ont payé les dettes.
- Est-ce que Mme Loisel a changé après la perte et les dettes ? Comment ? Qu’a fait son mari ?
- Pourquoi Mme Loisel a-t-elle abordé Mme Forestier ? Qu’est-ce qu’elle lui a raconté ? Pourquoi ?
- Pourquoi Mme Forestier n’a-t- elle pas reconnu Mme Loisel ? Comment trouvez-vous sa réaction à l’histoire de la perte ?
- Quelle est votre réaction à la fin de l’histoire ? En êtes-vous surpris ou surprise ?
- A votre avis, quel est le but de Maupassant dans cette histoire ?
Exercice F. Compréhension du texte II
Le Petit Prince d’Antoine Saint-Exupéry est un roman situé dans le désert. Un pilote raconte l’histoire de sa panne d’avion et il reste seul dans le désert, où il rencontre un garçon, le prince, qui commence à lui parler. Il demande que le pilote lui dessine un mouton, qui va vivre sur sa planète avec lui. Il faut que le mouton soit très petit, à cause de la taille de la planète.
Lisez l’extrait du Petit Prince ci-dessous et puis travaillez avec un ou une partenaire pour bien discuter les questions.
J’avais ainsi appris une seconde chose très importante : C’est que sa planète d’origine était à peine plus grande qu’une maison !
Ça ne pouvait pas m’étonner beaucoup. Je savais bien qu’en dehors des grosses planètes comme la Terre, Jupiter, Mars, Vénus, auxquelles on a donné des noms, il y en a des centaines d’autres qui sont quelquefois si petites qu’on a beaucoup de mal à les apercevoir au télescope. Quand un astronome découvre l’une d’elles, il lui donne pour nom un numéro. Il l’appelle par exemple : « l’astéroïde 3251. »
J’ai de sérieuses raisons de croire que la planète d’où venait le petit prince est l’astéroïde B 612. Cet astéroïde n’a été aperçu qu’une fois au télescope, en 1909, par un astronome turc.
Il avait fait alors une grande démonstration de sa découverte à un Congrès International d’Astronomie. Mais personne ne l’avait cru à cause de son costume. Les grandes personnes sont comme ça.
Heureusement pour la réputation de l’astéroïde B 612 un dictateur turc imposa à son peuple, sous peine de mort, de s’habiller à l’Européenne. L’astronome refit sa démonstration en 1920, dans un habit très élégant. Et cette fois-ci tout le monde fut de son avis.
Si je vous ai raconté ces détails sur l’astéroïde B 612 et si je vous ai confié son numéro, c’est à cause des grandes personnes. Les grandes personnes aiment les chiffres. Quand vous leur parlez d’un nouvel ami, elles ne vous questionnent jamais sur l’essentiel. Elles ne vous disent jamais : « Quel est le son de sa voix ? Quels sont les jeux qu’il préfère ? Est-ce qu’il collectionne les papillons ? » Elles vous demandent : « Quel âge a-t-il ? Combien a-t-il de frères ? Combien pèse-t-il ? Combien gagne son père ? » Alors seulement elles croient le connaître. Si vous dites aux grandes personnes : « J’ai vu une belle maison en briques roses, avec des géraniums aux fenêtres et des colombes sur le toit… » elles ne parviennent pas à s’imaginer cette maison. Il faut leur dire : « J’ai vu une maison de cent mille francs. » Alors elles s’écrient : « Comme c’est joli ! »
Ainsi, si vous leur dites : « La preuve que le petit prince a existé c’est qu’il était ravissant, qu’il riait, et qu’il voulait un mouton. Quand on veut un mouton, c’est la preuve qu’on existe » elles hausseront les épaules et vous traiteront d’enfant ! Mais si vous leur dites : « La planète d’où il venait est l’astéroïde B 612 » alors elles seront convaincues, et elles vous laisseront tranquille avec leurs questions. Elles sont comme ça. Il ne faut pas leur en vouloir. Les enfants doivent être très indulgents envers les grandes personnes.
Mais, bien sûr, nous qui comprenons la vie, nous nous moquons bien des numéros ! J’aurais aimé commencer cette histoire à la façon des contes de fées. J’aurais aimé dire « Il était une fois un petit prince qui habitait une planète à peine plus grande que lui, et qui avait besoin d’un ami… » Pour ceux qui comprennent la vie, ça aurait eu l’air beaucoup plus vrai.
Exercice G. Bavardons !
Travaillez avec un ou une partenaire et discutez ces questions.
- Comment est-ce que le pilote sait que la planète du petit prince n’est pas grande ? Pourquoi est-ce que le prince demande un mouton ?
- Le pilote décide que la planète est l’astéroïde B 612. Qu’apprenons-nous de la découverte de la planète ? Comment est-ce que l’astronome arrive à convaincre ses auditeurs de sa découverte ? Pourquoi est-ce que ce changement est important ? Quel est le but de ce commentaire du narrateur ?
- Le pilote parle de « l’essentiel » pour un enfant et celui des « grandes personnes ». Tracez les différences pour ces choses : la planète, un nouvel ami, une maison, et le petit prince. Est-ce que vous pouvez caractériser les différences ? Quel est l’objectif de ces différences à votre avis ?
- Trouvez-vous que le narrateur a bien décrit les différences entre le point de vue des enfants et celui des grandes personnes ?
Exercice H. Écrivons !
Écrivez un sommaire du texte qui inclut vos réponses aux questions ci-dessus.
Exercice I. À vous maintenant !

Le Père Goriot est un roman d’Honoré de Balzac publié en parties dans la Revue de Paris et puis en livre en 1842. C’est l’histoire d’un jeune étudiant en droit, Eugene de Rastignac qui habite dans une pension bourgeoise avec d’autres hommes. Un de ces hommes est M. Goriot, qui au début du roman a de l’argent et de confiance et est bien tenu. Il devient l’ami de Rastignac, et l’encourage à entrer dans une liaison avec sa fille Delphine de Nucingen. Cette femme est mariée, et la liaison va aider Rastignac à entrer dans la société et à prospérer dans sa vie à Paris.
Lisez l’extrait de Le Père Goriot pour bien discuter les questions qui suivent.
– Allons, montons, dit-il [le père Goriot] à Rastignac en lui faisant traverser une cour et le conduisant à la porte d’un appartement situé au troisième étage, sur le derrière d’une maison neuve et de belle apparence. Le père Goriot n’eut pas besoin de sonner. Thérèse, la femme de chambre de madame de Nucingen, leur ouvrit la porte. Eugène se vit dans un délicieux appartement de garçon, composé d’une antichambre, d’un petit salon, d’une chambre à coucher et d’un cabinet ayant vue sur un jardin. Dans le petit salon, dont l’ameublement et le décor pouvaient soutenir la comparaison avec ce qu’il y avait de plus joli, de plus gracieux, il aperçut, à la lumière des bougies, Delphine, qui se leva d’une causeuse, au coin du feu, mit son écran sur la cheminée, et lui dit avec une intonation de voix chargée de tendresse :
– Il a donc fallu vous aller chercher, monsieur qui ne comprenez rien.Thérèse sortit. L’étudiant prit Delphine dans ses bras, la serra vivement et pleura de joie. Ce dernier contraste entre ce qu’il voyait et ce qu’il venait de voir, dans un jour où tant d’irritations avaient fatigué son cœur et sa tête, détermina chez Rastignac un accès de sensibilité nerveuse.
– Je savais bien, moi, qu’il t’aimait, dit tout bas le père Goriot à sa fille pendant qu’Eugène abattu gisait sur la causeuse sans pouvoir prononcer une parole ni se rendre compte encore de la manière dont ce dernier coup de baguette avait été frappé. [—]
– Ah ! voilà ce que je voulais. Vous ne ferez pas attention à moi, n’est-ce pas ? J’irai, je viendrai comme un bon esprit qui est partout, et qu’on sait être là sans le voir. Eh ! bien, Delphinette, Ninette, Dedel ! n’ai-je pas eu raison de te dire : « Il y a un joli appartement rue d’Artois, meublons-le pour lui ! » Tu ne voulais pas. Ah ! c’est moi qui suis l’auteur de ta joie, comme je suis l’auteur de tes jours. Les pères doivent toujours donner pour être heureux. Donner toujours, c’est ce qui fait qu’on est père. [—]
– A-t-on bien deviné vos vœux ? dit-elle en revenant dans le salon pour se mettre à table.
– Oui, dit-il, trop bien. Hélas ! ce luxe si complet, ces beaux rêves réalisés, toutes les poésies d’une vie jeune, élégante, je les sens trop pour ne pas les mériter ; mais je ne puis les accepter de vous, et je suis trop pauvre encore pour… […]
– Enfant ! vous êtes à l’entrée de la vie, reprit-elle en saisissant la main d’Eugène, vous trouvez une barrière insurmontable pour beaucoup de gens, une main de femme vous l’ouvre, et vous reculez ! Mais vous réussirez, vous ferez une brillante fortune, le succès est écrit sur votre beau front. Ne pourrez-vous pas alors me rendre ce que je vous prête aujourd’hui ? Autrefois les dames ne donnaient-elles pas à leurs chevaliers des armures, des épées, des casques, des cottes de mailles, des chevaux, afin qu’ils pussent aller combattre en leur nom dans les tournois ? Eh ! bien, Eugène, les choses que je vous offre sont les armes de l’époque, des outils nécessaires à qui veut être quelque chose. Il est joli, le grenier où vous êtes, s’il ressemble à la chambre de papa. Voyons, nous ne dînerons donc pas ? Voulez-vous m’attrister ? Répondez donc ? dit-elle en lui secouant la main. Mon Dieu, papa, décide-le donc, ou je sors et ne le revois jamais.
– Je vais vous décider, dit le père Goriot en sortant de son extase. Mon cher monsieur Eugène, vous allez emprunter de l’argent à des juifs, n’est-ce pas ?
– Il le faut bien, dit-il.
– Bon, je vous tiens, reprit le bonhomme en tirant un mauvais portefeuille en cuir tout usé. Je me suis fait juif, j’ai payé toutes les factures, les voici. Vous ne devez pas un centime pour tout ce qui se trouve ici. Ça ne fait pas une grosse somme, tout au plus cinq mille francs. Je vous les prête, moi ! Vous ne me refuserez pas, je ne suis pas une femme. Vous m’en ferez une reconnaissance sur un chiffon de papier, et vous me les rendrez plus tard.
Quelques pleurs roulèrent à la fois dans les yeux d’Eugène et de Delphine, qui se regardèrent avec surprise. Rastignac tendit la main au bonhomme et la lui serra.
– Eh ! bien, quoi ! n’êtes-vous pas mes enfants ? dit Goriot.
– Mais, mon pauvre père, dit madame de Nucingen, comment avez-vous donc fait ?
– Ah ! nous y voilà, répondit-il. Quand je t’ai eu décidée à le mettre près de toi, que je t’ai vue achetant des choses comme pour une mariée, je me suis dit : « Elle va se trouver dans l’embarras ! » L’avoué prétend que le procès à intenter à ton mari, pour lui faire rendre ta fortune, durera plus de six mois. Bon. J’ai vendu mes treize cent cinquante livres de rente perpétuelle ; je me suis fait, avec quinze mille francs douze cents francs de rentes viagères bien hypothéquées, et j’ai payé vos marchands avec le reste du capital, mes enfants. Moi, j’ai là-haut une chambre de cinquante écus par an, je peux vivre comme un prince avec quarante sous par jour, et j’aurai encore du reste. Je n’use rien, il ne me faut presque pas d’habits. Voilà quinze jours que je ris dans ma barbe en me disant : « Vont-ils être heureux ! » Eh ! bien, n’êtes-vous pas heureux ?
– Oh ! papa, papa ! dit madame de Nucingen en sautant sur son père qui la reçut sur ses genoux. Elle le couvrit de baisers, lui caressa les joues avec ses cheveux blonds, et versa des pleurs sur ce vieux visage épanoui, brillant. – Cher père, vous êtes un père ! Non, il n’existe pas deux pères comme vous sous le ciel. Eugène vous aimait bien déjà, que sera-ce maintenant !
– Mais, mes enfants, dit le père Goriot qui depuis dix ans n’avait pas senti le cœur de sa fille battre sur le sien, mais, Delphinette, tu veux donc me faire mourir de joie ! Mon pauvre cœur se brise. Allez, monsieur Eugène, nous sommes déjà quittes !
Exercice J. Discutons !
Répondez aux questions avec un ou une partenaire.
- Comment est-ce que vous caractérisez Goriot ? Trouvez-vous que ses actions vis à vis sa fille (et Rastignac) sont naturelles ou de trop ? (Considérez les bénéfices pour lui si Rastignac accepte ces suggestions). Où va-t-il habiter si ses projets se réalisent ?
- Croyez-vous que Delphine aime son père ? Quelles indications y a-t-il qu’elle ne soit pas vraiment honnête quand elle lui parle ?
- Regardons Rastignac et ses émotions. Aime-t-il Delphine ? Est-il reconnaissant du cadeau que le vieux home leur a offert ?
- Comment est-ce que Balzac intéresse et engage le lecteur ? Suivez le développement de lieux, les personnages et leurs conversations, et les révélations de Goriot et les émotions suscitées de Delphine et de Rastignac.
Exercice K. Écrivons !
Ecrivez une sommaire de cet extrait, incluant les caractères des personnages, leurs attitudes l’un à l’autre, leurs buts, et cetera. Utilisez les réponses que vous avez faites ci-dessus à vous aider.
des biens ou de l'argent apportés au mari par l'épouse ou de son père
un employé
la détérioration
un tissue luxueux
colère ; impatience
habillée
une arme à feu
collier en diamants
avec passion
excitée ; ravie
paniquée
se leva
désespéré
double épaisseur obtenue par le tissu replié une fois sur lui-même
consternés
écrasée
de l'argent pour le retour de quelque chose (ici, le collier)
de terreur
contrats
des prêteurs d'argent à taux élevé
pauvreté
vexée
la boîte
un grenier ; une petite pièce sous le toit
une pièce d'ancienne monnaie française (pièce à pièce)
se détendre
tâches
des oiseaux, symboles de la paix
lever les épaules (zone entre cou et bras)
être fâché contre eux
À l’époque, les mariages étaient une forme d’agrandissement dans la société. On ne se mariait pas à cause d’amour et les liaisons hors du mariage était ordinaires.
un sofa
objet tient à la main pour se protéger de la chaleur et de la luminosité du feu
s’étendait
surprise extraordinaire
porter une action en justice
revenu à vie